L'obèse
L’obésité est définie par un indice de masse corporelle (IMC) > 30.
Au-delà d’un IMC > 40, on parle d’obésité morbide, et > 50, de super obèse.
La prise en charge d’un patient obèse présente des spécificités en termes de risques : risque hypoxique et cardio-vasculaire majorés, difficulté de conditionnement entre autres. Concernant la prise en charge médicamenteuse, la connaissance des modifications du devenir des produits spécifiques à l’anesthésie doivent permettre à l’équipe de choisir le protocole le plus adapté au patient et ainsi d’optimiser sa prise en charge.
Modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
- Lors de l’absorption
Le surpoids en lui-même ne modifie pas l’absorption digestive des agents.
- Lors de la distribution
Chez l’obèse, on constate une augmentation du taux de protéine acide (en lien avec des phénomènes inflammatoires) sur lesquels les agents basiques vont se fixer entrainant une diminution de la fraction libre active du médicament. C’est le cas du sufentanil. En revanche, la liaison des agents acides liés à l’albumine n’est pas modifiée, le propofol en faisant partie.
La masse grasse, le volume sanguin et tous les principaux organes voient leurs volumes augmenter. Ainsi le volume du compartiment central (V1 sur schéma – cf étapes précédentes) s’accroit d’où la nécessité d’administrer une dose initiale plus importante pour obtenir un même effet.
Enfin, dans les tissus adipeux, la distribution est fonction de la liposolubilité de la molécule. Le propofol par exemple franchit aisément les barrières lipidiques, et en cela, un risque d’accumulation et d’effet prolongé est existant.
- L’élimination
Le métabolisme hépatique au final est peu modifié. Certes le patient obèse présente une augmentation du débit cardiaque, splanchnique et une augmentation du volume sanguin, mais le métabolisme hépatique n'est pas forcément plus important. Ce d’autant plus qu’il existe une infiltration adipeuse des cellules hépatiques entrainant, à terme, une « fibrose hépatique ».
L’élimination rénale et donc la clairance sont augmentées de par l’accroissement de la taille du rein, de la filtration glomérulaire, et de l’extraction glomérulaire associée.
Mais concrètement dans la pratique, les répercussions sont d’une part liées à ces modifications mais aussi aux caractéristiques de la molécule injectée, et concernant l’AIVOC, du morphinique et/ou de l’hypnotique.
Usage des produits anesthésiques
- Concernant le propofol
Le propofol est un agent liposoluble mais au final, la demi-vie d’élimination de ce produit n’est pas plus importante chez ces patients.
Lors de l’entretien de l’anesthésie, la dose en mg/kg de propofol administré est ajustée au poids réel.
Mais à l’induction, la dose sera plutôt adaptée au poids idéal devant le risque cardiovasculaire, lié à une probable hypertension et cardiopathie. Une titration va pouvoir s’imposer et dans ce cadre là, l’AIVOC présente tout son intérêt.
Deux modèles pharmacocinétiques sont alors utilisables : Schnider et Marsh.
 Le modèle de Schnider présente comme covariables de la clairance du propofol, l’âge et la masse maigre. Or une masse maigre trop faible va entrainer une surestimation de la clairance et, par conséquent, augmenter la dose de propofol administrée. Ce modèle n’est donc pas approprié à cette population.
Le modèle de Schnider présente comme covariables de la clairance du propofol, l’âge et la masse maigre. Or une masse maigre trop faible va entrainer une surestimation de la clairance et, par conséquent, augmenter la dose de propofol administrée. Ce modèle n’est donc pas approprié à cette population.
 Le modèle de Marsh dont les volumes et la clairance sont proportionnels au poids total est plus particulièrement adapté à ces patients, notamment chez les obèses morbides où l’on a pu constater que ce modèle correspondait parfaitement aux données scientifiques sur la cinétique du propofol.
Le modèle de Marsh dont les volumes et la clairance sont proportionnels au poids total est plus particulièrement adapté à ces patients, notamment chez les obèses morbides où l’on a pu constater que ce modèle correspondait parfaitement aux données scientifiques sur la cinétique du propofol.
- Concernant les morphiniques
Le volume de distribution du sufentanil est augmenté chez les obèses et l’élimination du produit est ralenti. Il faudra donc veiller à diminuer les doses de sufentanil.
 Le rémifentanil, de par son petit volume de distribution, sa clairance élevée et l’absence d’effets résiduels en fait un agent de choix chez l’obèse.
Le rémifentanil, de par son petit volume de distribution, sa clairance élevée et l’absence d’effets résiduels en fait un agent de choix chez l’obèse.
Dans tous les cas, l’administration des morphiniques doit rester prudente chez ces patients particulièrement exposés au risque d’hypoxémie.
Conséquences pour la pratique clinique
Les modèles de Schnider (propofol) (mais l’on rappelle que ce n’est pas celui à privilégier chez ces patients) et de Minto (rémifentanil) ne doivent pas être utilisés sans correction chez l’obèse car ils utilisent, comme expliqué dans le point précèdent, des modèles pharmacocinétiques pondérés par la masse maigre.
Une formule existe pour estimer la masse maigre en fonction du poids réels (la formule de James) ; mais au delà d’un IMC > 42kg/m² chez l’homme ou > 35 kg/m² chez la femme, elle donnait des résultats faux et donc exposait à un risque de sous-dosage du rémifentanil et de surdosage du propofol.
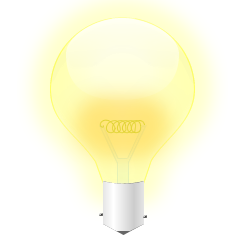 Comme par ailleurs, ces populations restent une excellente indication à l’AIVOC, on peut préférer l’utilisation du modèle de Marsh pour le propofol et pour le rémifentanil, sous-estimer le poids de ces patients tout en gardant la valeur maximale de la masse maigre (donc de rentrer dans le pousse-seringue, le poids le plus haut accepté) et de toujours garder à l’esprit que l’on sous-estime les doses d’autant plus que l’IMC du patient est élevé.
Comme par ailleurs, ces populations restent une excellente indication à l’AIVOC, on peut préférer l’utilisation du modèle de Marsh pour le propofol et pour le rémifentanil, sous-estimer le poids de ces patients tout en gardant la valeur maximale de la masse maigre (donc de rentrer dans le pousse-seringue, le poids le plus haut accepté) et de toujours garder à l’esprit que l’on sous-estime les doses d’autant plus que l’IMC du patient est élevé.
Lorsque l’on utilise le modèle de Marsh, une autre source recommande de prendre comme poids : le poids idéal + 0,4 fois l'excès de poids.
Le poids idéal selon Lemmens peut-être calculé par 22 x (taille(m)²).
Les posologies de morphiniques semblent elles devoir être basées sur le poids idéal et tous sont aussi efficaces pour prévenir la réponse adrénergique à l’intubation. Ces informations incitent donc à utiliser le rémifentanil et à comparer la dose cumulée lors d’une administration en mode AIVOC par rapport à une administration manuelle, et ce, à partir du poids réel. Cela permet un rétrocontrôle supplémentaire.
NB : L’AIVOC peut être envisagée chez le patient estomac plein. Le patient obèse qui présente des signes de reflux gastro-oesophagien est considéré comme tel.
Dans ce cadre-ci, la cible d’induction doit être augmentée pour que la dose initiale corresponde à celle recommandée en injection manuelle, en sachant que ce surdosage initial accélère la perte de conscience mais expose à un risque d’hypotension.
La personne âgée
Modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
- Lors de l’absorption
C'est la vitesse d’absorption qui est modifiée, soit le Tpeack effect qui est augmenté.
- Lors de la distribution
Avec l’âge, le volume de distribution est modifié de par l’augmentation de la masse graisseuse au détriment de la masse musculaire, par diminution de la quantité d’eau corporelle totale, par diminution de la perfusion sanguine des tissus et une modification de la liaison aux protéines plasmatiques.
La réduction du volume sanguin total observée chez la personne âgée entraîne une diminution du volume de distribution central. Cette dernière est à l'origine d'une augmentation des concentrations plasmatiques maximales qui expliquent la sensibilité accrue des patients âgés à certains agents anesthésiques.
L'augmentation de la masse graisseuse au détriment de la masse musculaire entraîne une augmentation du volume de distribution des molécules liposolubles et une diminution du volume de distribution des molécules hydrosolubles.
Enfin, en lien avec la diminution du débit cardiaque, la répartition dans les différents volumes va être modifiée entrainant des délais et des durées d’action prolongés, d’autant plus si il y a redistribution vers un troisième compartiment. Le temps de décroissance est allongé pour la plupart des agents.
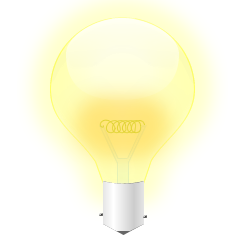 Pour pallier à cela, les doses d’induction doivent être diminuées.
Pour pallier à cela, les doses d’induction doivent être diminuées.
Le métabolisme hépatique diminue d’environ 30% après 70 ans. La diminution de la masse hépatique, du flux sanguin hépatique en sont à l’origine.
- Lors de l’élimination
Le flux sanguin rénal diminue avec l’âge d’environ 1% par an à partir de 50 ans. En dehors de toute pathologie spécifique, une baisse de la filtration glomérulaire en fonction de l’âge est normale.
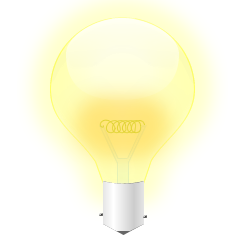 En fait, les posologies de médicaments doivent être réajustées à partir de la norme de la clairance de la créatinine, qui est le marqueur reflétant les capacités d’élimination du rein.
En fait, les posologies de médicaments doivent être réajustées à partir de la norme de la clairance de la créatinine, qui est le marqueur reflétant les capacités d’élimination du rein.
Usage des produits anesthésiques
Les besoins de propofol sont diminués chez le patient âgé car l’âge entraine une augmentation de la sensibilité à ses effets hypnotiques. Les effets hémodynamiques sont plus importants et plus tardifs que chez le sujet jeune à apparaître. Grossièrement, les mêmes effets cliniques sont observables mais à des concentrations plus faibles.
Les propriétés pharmacodynamiques, du propofol et des morphiniques sont significativement affectées avec l'âge. Le cerveau au cours du vieillissement devient plus sensible à ces agents.
Conséquences pour la pratique clinique
- Pour le propofol
Avec le diprifusor®, le modèle pharmacocinétique de Marsh (adultes jeunes, ajusté au poids) sous-estime les concentrations chez les patients âgés, ce qui impose de réduire la concentration cible par rapport à un sujet jeune et de titrer l’administration de propofol selon les effets cliniques observés (perte de conscience, effets secondaires…).
 Les modèles pharmacocinétiques qui n’intègrent pas l’âge comme covariables doivent être utilisés avec prudence dans cette population.
Les modèles pharmacocinétiques qui n’intègrent pas l’âge comme covariables doivent être utilisés avec prudence dans cette population.
Avec d’autres dispositifs de perfusion, laissant le choix entre l’utilisation du modèle de Schnider et de Marsh, le choix du modèle de Schnider s’impose, associé à une induction progressive en titration. Elle permettra de reconnaitre précisément la concentration efficace et de limiter les effets délétères.
Le délai d’action et le temps d’équilibration du propofol mais aussi de la plupart des agents sont allongés. Le temps d’endormissement sera plus long et la titration devra être réalisée en augmentant par palier les concentrations-cibles, toutes les 3 à 4 minutes seulement.
Chez le grand vieillard, si l’hypnotique choisi est le propofol, il est recommandé de l’administrer en AIVOC en utilisant le modèle de Schnider, de réaliser une titration soigneuse et de synchroniser les pics d’action du propofol et du morphinique associé avec la stimulation douloureuse. Pour ce faire, un morphinique de délai bref sera privilégié comme le rémifentanil. Toutefois, l’âge modifie la pharmacocinétique et la pharmacodynamie de ce dernier.
- Les morphiniques
La dose initiale de rémifentanil doit être réduite de moitié au moins, et les posologies d’entretien des deux tiers. Le risque de surdosages et les effets secondaires en découlant lors de l’administration au pousse-seringue incitent à l’utiliser en mode AIVOC basé sur le modèle de MINTO, ajusté à l’âge.
Concernant le sufentanil, ses paramètres pharmacocinétiques sont peu modifiés par l’âge à l’exception de la baisse du volume initial de distribution qui va conduire à un pic plasmatique plus important. Le sufentanil étant liposoluble, son volume de distribution va donc être augmenté et il y aura un risque d’accumulation. Ainsi, il est recommandé de diminuer les concentrations de 50% par rapport à la population générale.
Actuellement des données manquent en ce qui concerne les concentrations chez les grands vieillards dont le nombre s’accroît, mais une titration fine dès l’induction permet d’adapter la concentration à l’effet et les concentrations doivent être systématiquement réduites, à l’induction comme lors de l’entretien.
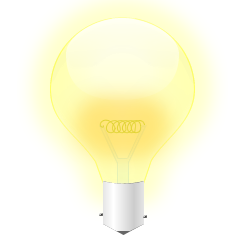 Moduler la vitesse d’injection sur la base d’AIVOC notamment si le diamètre de la VVP est petit, si la veine est fragilisée par des traitements corticoïdes permet de conserver la voie d’abord souvent précieuse et d’entrainer moins de répercussions HDM.
Moduler la vitesse d’injection sur la base d’AIVOC notamment si le diamètre de la VVP est petit, si la veine est fragilisée par des traitements corticoïdes permet de conserver la voie d’abord souvent précieuse et d’entrainer moins de répercussions HDM.
En effet, plus la vitesse d’injection est lente, plus la baisse de la pression artérielle sera moindre. Or, chez ces patients potentiellement porteurs de sténose carotidienne, et au vu du ralentissement du débit sanguin cérébral, le maintien de la pression artérielle, et donc de la pression de perfusion cérébrale doit être une préoccupation permanente. Le retentissement ventilatoire et la survenue d’apnées sont également corrélés à la vitesse d’injection.

Les pousses-seringues actuels ont un débit de 1000 à 1500ml/h, qui correspondent à une vitesse d’injection d’un bolus manuel. Ainsi, il faut avant de débuter l’induction d’un sujet âgé, penser à la diminuer.